Indexé dans
- Ouvrir la porte J
- Clés académiques
- JournalTOCs
- RechercheRef
- Université Hamdard
- EBSCO AZ
- OCLC - WorldCat
- Google Scholar
Liens utiles
Partager cette page
Dépliant de journal
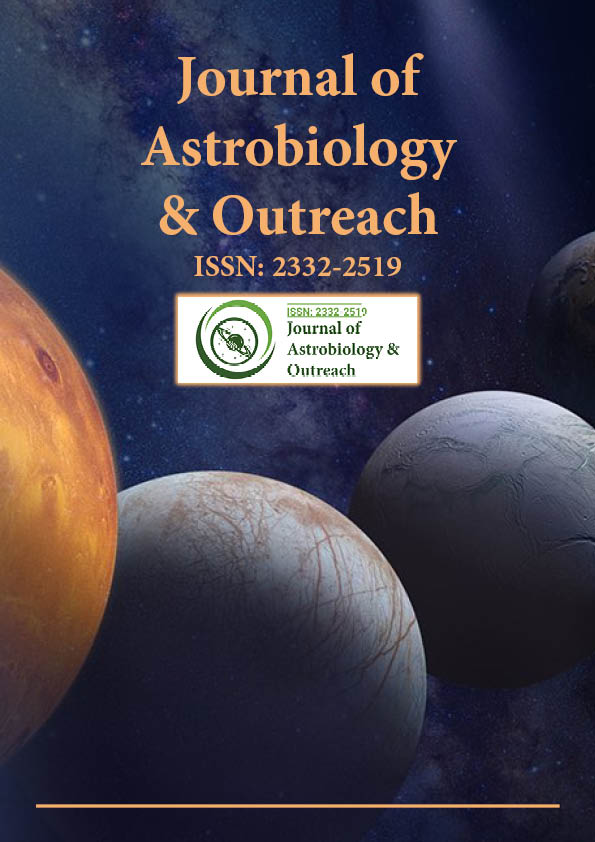
Revues en libre accès
- Agriculture et aquaculture
- Alimentation et nutrition
- Biochimie
- Bioinformatique et biologie des systèmes
- Business & Management
- Chimie
- Génétique et biologie moléculaire
- Immunologie & Microbiologie
- Ingénierie
- La science des matériaux
- Neurosciences & Psychologie
- Science générale
- Sciences cliniques
- Sciences environnementales
- Sciences médicales
- Sciences pharmaceutiques
- Sciences vétérinaires
- Soins infirmiers et soins de santé
Abstrait
Le test d'attitude de communication pour les adultes qui bégaient (BigCAT) : une étude de fiabilité test-retest chez les adultes qui bégaient et ceux qui ne bégaient pas
Mohammed Hassan Babak
L'idée selon laquelle non seulement la partie évidente du bégaiement est normale chez la
personne qui chancelle (PQB), mais que d'autres éléments constituent l'ensemble de
ce qui constitue un PQB est largement reconnue. Lorsqu'une personne qui chancelle
atteint l'âge adulte, les liens affectifs, sociaux et intellectuels du bégaiement se sont
développés en fonction de l'histoire de l'expérience. Les séquelles existantes du trouble se sont
intensifiées et solidifiées et différentes expériences, les unes après les autres, ont ajouté à la
nature multiforme du trouble. Les variables contributives du problème du bégaiement s'identifient
à une réaction émotionnelle négative, à la tension et au stress évoqués par des sons ou
des mots spécifiques ainsi qu'à différentes circonstances de discours qui sont redoutées et
provoquent généralement une rupture du discours. Il peut être amené à adopter des pratiques adaptatives pour
s'attendre à un bégaiement ou pour éviter son apparition. Ces expériences conduisent souvent à
des pensées négatives et créent une attitude négative envers le discours. Ces segments internes qui accompagnent
le bégaiement sont mieux étudiés par la réflexion et servent à élargir les
perceptions faites par le clinicien. Outre l'utilisation d'entretiens, l'approche la plus méthodique
pour rechercher les traits innés qui accompagnent le bégaiement consiste à organiser des
mesures d'auto-évaluation. À partir du milieu des années 1900, divers
efforts subjectifs et quantitatifs ont été réalisés par des cliniciens et des praticiens pour évaluer et
comparer la mentalité des PWW avec celle des personnes qui ne bégaient pas (PWNS). Parmi les
stratégies de test actuellement accessibles aux adultes, rares sont celles qui permettent d'évaluer
le comportement de communication d'une manière qui ne soit pas perturbée par des facteurs qui étudient d'autres
concomitants du bégaiement qui sont de nature plus dysfonctionnelle et sociale.